Note de lecture : « La marche de l'histoire », de V. Citot et J.-F. Dortier

La première chose à relever dans cet ouvrage récemment paru aux éditions Sciences humaines est l’originalité de sa forme. Il s'agit d’un livre d’entretiens, mais où les deux protagonistes sont placés sur un pied d’égalité. Il n’y a pas, comme le plus souvent, un interviewer et un interviewé, l’un qui poserait des questions avec une candeur plus ou moins feinte, et l’autre qui y répondrait. Le parti-pris du texte est de mettre en scène un dialogue entre deux participants qui, s’ils partagent les mêmes interrogations, divergent parfois sur les réponses à y apporter. Précisons que ce dialogue en est vraiment un : les auteurs ne se sont pas contentés de lister des questions, puis d’y répondre chacun de leur côté. Le lecteur se trouve plongé dans une véritable discussion, où les arguments font écho les uns aux autres, et où chaque interlocuteur écoute – à défaut d’approuver – ce que l’autre énonce. Ce choix contribue bien évidemment à rendre la lecture de l’échange particulièrement plaisante.
Le second aspect qui retient l'attention est l’ambition du propos. Celui-ci traite de grandes questions : la marche des sociétés humaines, qu’il s'agisse de leur technique, de leur organisation ou de leurs produits intellectuels, suit-elle une logique, et laquelle ? Quel est le poids des idées dans le changement social ? Quels en sont les autres facteurs ? Comment s’articule le caractère général de l’évolution sociale (en particulier, les convergences évolutives observées), avec la grande variabilité des trajectoires locales ? Les cultures s’inscrivent-elles dans une histoire cyclique ? Peut-on parler de « progrès » ? Comment expliquer l’émergence de l'État ? Etc. Non seulement ces questions, trop souvent évitées par la littérature savante, sont ici abordées de front, mais elles le sont de la meilleure des manières, avec un constant souci de clarté et sans la moindre volonté de noyer le poisson dans des considérations fumeuses ou un vocabulaire jargonneux.
Ce constat n’a rien pour surprendre, quand on connaît le parcours des deux auteurs. Jean-François Dortier est le fondateur du groupe Sciences Humaines, qui s'efforce depuis des années de proposer une vulgarisation de qualité des débats qui touchent à l'ensemble de ces sujets. Quant à Vincent Citot, il fait partie de ces trop rares philosophes à considérer qu’il est essentiel de réfléchir à partir de données tangibles, et de le faire de manière à être compris de ses contemporains – en d’autres termes, ses écrits illustrent l’adage selon lequel la clarté n’est pas synonyme de superficialité, et l’obscurité de profondeur.
Tout cela produit un ouvrage très stimulant et hautement recommandable, dans la mesure où il réussit à être tout à la fois érudit et accessible. On peut dire de lui qu’il aborde l'ensemble des questions que doit se poser tout scientifique (et plus généralement, tout individu) désireux de comprendre le devenir des sociétés humaines. Loin d’être problématiques, les points de divergence – auxquels on pourrait ajouter celles que le lecteur pourra lui-même parfois ressentir – appellent au contraire à pousser la réflexion, et de très nombreuses références permettront de le faire en prenant connaissance des travaux des spécialistes des différentes disciplines convoquées.
La marche de l’histoire.
Évolution des sociétés, cultures et idées, des clans préhistoriques au 21e siècle.
Dialogue entre Vincent Citot et Jean-François Dortier
Sciences Humaines, collection Essais
230 pages. Version papier 18 €, électronique 15 €
Pour la bonne bouche et pour finir, quelques morceaux choisis (j’ai volontairement omis de préciser lequel des deux auteurs avait tenu chacun d’eux, cela fait partie du teasing) :
J’ai toujours refusé que la philosophie soit une spécialité d’initiés ; et, contre beaucoup de mes collègues, j’ai systématiquement défendu les pratiques et usages non professionnels de ma discipline. Non par charité, mais parce qu’il arrive que les non-spécialistes posent des questions plus frontales, plus authentiques et finalement plus philosophiques. Tandis que, trop souvent, les philosophes professionnels se perdent dans des considérations techniques, dans un jargon convenu et des références révérencieuses à « la tradition ». (14)
Le travail de l’historien ne consiste pas à restituer le passé selon la vision du monde en vigueur dans ce passé même. Sinon, il faudrait être animiste pour parler des animistes, aztèque pour parler des Aztèques, etc. (20)
Il me semble aussi faux de dire que l’infrastructure détermine de façon univoque le contenu des idées que de prétendre que ces idées flottent en l’air sans lien avec les conditions socioéconomiques. On ne peut expliquer la doctrine de Platon simplement en faisant une analyse sociologique du milieu où il a vécu. Mais le platonisme comme geste philosophique, orientation intellectuelle et pôle d’attraction des esprits de la première moitié du 4e siècle av. J.-C. s’explique largement par le contexte socio-historique. (28)
Pourquoi la philosophie est apparue en Grèce, en Chine, en Inde puis en Islam, et pas en Mésopotamie ou en Égypte (autant qu’on sache) ? Parce que davantage qu’en Mésopotamie et en Égypte, la Grèce était divisée en cités concurrentes, la Chine en Royaumes combattants, l’Inde gangétique du 6e siècle avant notre ère en unités politiques et en sectes dissidentes, et l’Islam en factions ou écoles rivales. Ces unités (politiques, économiques ou religieuses) étaient en concurrence, y compris sur le plan intellectuel. Les clercs, les conseillers du prince ou les penseurs en général qui les représentaient ou qui voyageaient d’une cité à l’autre devaient hisser leur niveau de raisonnement pour se maintenir à l’avant-garde. (30)
Le pouvoir des intellectuels et des maîtres penseurs ne leur vient pas des idées qu’ils défendent, mais de leur position sociale. Ce ne sont pas les idées qui ont du pouvoir (la raison est bien faible, disait Pascal ; sa force sociale est négligeable, renchérit Le Bon), mais ceux qui les portent (qu’il s’agisse du « peuple » ou des « élites »). (69)
En toute rigueur, il faudrait distinguer deux niveaux de complexité : la complexité sociale (diversification plus ou moins prononcée des rapports sociaux) et la complexité culturelle (diversification plus ou moins prononcée des produits de ces rapports). Le degré de complexité social se mesure par le niveau de division du travail (diversité des métiers) et d’organisation hiérarchique (diversité des statuts – cela comprend les rapports de parenté, mais aussi l’ensemble des formes d’autorités politiques, administratives, religieuses, etc.). Le degré de complexité culturelle se mesure, non par la nature des rapports sociaux, mais par leurs résultats : diversité des institutions, des produits matériels, des services, des réalisations artistiques et intellectuelles. (82)
Je crois en effet qu’il n’y a pas à choisir entre histoire cyclique et histoire linéaire, car les deux conceptions sont vraies à des niveaux différents. Si l’on se concentre sur l’évolution d’une civilisation particulière, on voit un cycle ; mais dès que l’on prend un certain recul, on a affaire à des dynamiques cumulatives, les effets de cliquet et des diffusions massives, qui brouillent la vision cyclique. (145)
L’un des problèmes majeurs de l’histoire universelle (et de sa périodisation) est, comme tu le soulignes, le fait que l’humanité ne marche pas au même rythme. Les anti-évolutionnistes ajoutent que toutes les sociétés ne marchent même pas dans le même sens. Enfin, toutes les sociétés marchent-elles ? La critique de l’évolutionnisme est décisive pour les illusions qu’elle déconstruit : linéarité d’une histoire-progrès, repérage de grandes étapes nécessaires sur ce chemin unique, européocentrisme. Mais aboutir à la conclusion que l’histoire humaine ne connaît aucune orientation majeure, aucune ligne de force et qu’elle n’obéit à aucune loi, c’est à la fois un présupposé a-scientifique et une erreur dans l’analyse des faits. Car même si toutes les sociétés ne se transforment pas au même rythme, on repère dans l’histoire des phénomènes de convergence et une synchronicité relative. (157)


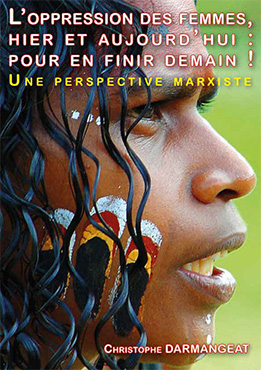

J'ai commencé la lecture de ton compte-rendu avec quelques gouttes de sueur/frayeur sur le front, car je sais que tu n'as pas la langue de bois, que tu ne te prives pas de dire ce qu'il faut dire, même quand ce n'est pas agréable, et surtout que les critiques que tu formules sont toujours justes (enfin, il me semble). La lecture terminée, me voilà tout détendu et très reconnaissant. Merci pour ton oeil généreux!
RépondreSupprimerPas de quoi, j'ai sincèrement bien aimé le livre (même si je pense qu'on pourrait rediscuter de tout cela point par point, avec éventuellement certaines divergences et que par ailleurs, nous avons probablement quelques solides désaccords politiques, mais c'est en large partie une autre histoire !). En tout cas, ce type de texte est vraiment le bienvenu, et j'espère qu'il aura un écho. Y a-t-il eu d'autres recensions ?
Supprimer