L'Énigme du profit : une question à propos du risque

Un internaute m’écrit pour me poser une question à propos d’un passage de L’Énigme du profit. Avec son accord, je la reproduis ici et réponds donc à la cantonade.
Bonjour,
J’ai lu votre livre avec beaucoup d’attention et il m’a beaucoup éclairé sur des questions que je me posais. Il demeure une zone d’ombre dans ma compréhension, celle où le capitaliste justifie la prise de la survaleur par le risque qu’il a pris. Comme vous le mentionnez, son risque est réel mais très limité car il se limite à un faible capital avancé (cf. les SARL, etc.) mais ici il s’agit d’un problème de degré et non de nature. De la même façon qu’une personne joue 1 € au casino, il gagne 100 €, son risque était très faible mais il a gagné gros et il justifie son gain par le risque qu’il a pris. On peut condamner cette attitude d’un point de vue moral, mais si l’idéologie d’une société place le risque de type casino comme étant légitime pour capter la survaleur, il est difficile de répondre à un petit actionnaire qu’il spolie.
Merci
Il me semble que cette question recouvre en fait trois problèmes différents, et qu’il faut les considérer séparément pour s’y retrouver.
Le premier aspect est de savoir si, dans une économie de libre entreprise, il existe une proportionnalité globale entre le degré de risque que présente un investissement et le taux de profit qu’il génère. À cela, la réponse est catégoriquement oui. Si les investissements se faisaient sans aucun risque, et que tout capitaliste était certain de récupérer son argent augmenté d’un profit, alors le taux de ce profit aurait tendance à s’égaliser, selon des mécanismes que Smith et Ricardo expliquaient déjà il y a deux siècles (en fait, il s’agit d’un processus contradictoire, où les différentiels de taux de profit ne cessent de se recréer, tout en étant contraints par des forces de rappel vers leur valeur moyenne).
Mais si l’on admet par exemple que certains secteurs sont marqués par un risque intrinsèque, il n’est pas difficile de voir que les mêmes mécanismes qui égalisent le taux de profit en l’absence de risque conduiront à faire apparaître au contraire un écart entre ces taux de profit pour tenir compte du risque. On peut illustrer cette idée par un petit calcul numérique. Imaginons que dans une économie capitaliste donnée, le taux de profit normal (moyen) soit de 10 %, et qu’il corresponde à des activités sans aucun risque. Si, dans cette économie, on pratique le commerce au long cours sur des navires, et qu’en raison des aléas de la navigation, un navire sur cinq coule durant la traversée, il va de soi que l’armateur doit toucher un profit qui lui assure non seulement les 10 % standard, mais qui lui permette de faire face aux 20 % de pertes liées à son activité. Le taux de profit (apparent) des compagnies de navigation sera donc de 30 %, ce qui leur assurera un taux de profit effectif (moyen) de 10 %. Évidemment on raisonne là dans le cadre d’une économie de libre concurrence absolue, où il n’y a pas de tricheurs qui se débrouillent pour avoir le beurre et l’argent du beurre. Dans la réalité, les capitalistes qui ne cessent de vanter les mérites de la concurrence et du risque font tout pour éviter de s’y confronter, et dès qu’ils peuvent faire jouer leurs amitiés étatiques pour s’assurer des profits garantis, ils ne s’en privent pas, et c’est ce à quoi je faisais allusion dans le livre, avec le cas de PPP (partenariats public-privé) ou des concessions autoroutières.
Tout cela est bel et bon. Toutefois, si ce qui précède nous dit que le taux de profit est corrélé au degré de risque, il s’en faut de beaucoup pour pouvoir affirmer à partir de là que c’est le risque qui engendre le profit. Bien qu’elles puissent paraître semblables, les deux idées sont en réalité totalement différentes, et passer sans crier gare de l’une à l’autre est une entourloupe. Pour preuve, je ne peux pas trouver mieux que ce que j’écrivais dans le livre : lorsqu’un piéton traverse une autoroute, ou qu’un alpiniste escalade un mur vertical, ils prennent un risque. Pour autant, ils n’en retirent aucun profit (sauf à monnayer les vidéos de leurs epxloits !). Il en va de même pour les salariés qui, partout dans le monde, effectuent des tâches qui leur coûtent parfois la vie. Dire que c’est le risque qui est la cause du profit, c’est donc dire en réalité que c’est le risque que prennent les capitaux qui est la cause du profit. Et cela nous ramène donc à la vraie question : pourquoi les capitaux, et eux seuls, possèdent-ils cette vertu étonnante de générer du profit ?
Enfin, il y a la question de la valeur morale attachée à l’argent gagné de telle ou de telle manière, par son travail, au casino, en dévalisant les petites vieilles ou en possédant des actions. Cette question se pose évidemment – nous avons tous des valeurs morales et ne pouvons agir sans elles – mais à la différence des deux précédentes, elle sort du domaine de la science. Il ne s’agit alors plus de comprendre (d’expliquer), mais de juger. Je dirais simplement que notre société ne voit aucune objection à ce que l’on puisse percevoir une partie des biens créés par le travail humain tout en n’ayant soi-même pas travaillé. Le simple droit de propriété, quelle que soit la forme précise sous laquelle il se manifeste, légitime le fait d’avoir accès à la richesse sociale au même titre que le travail effectué – et statistiquement, ce sont justement ceux qui oeuvrent le plus à créer cette richesse sociale qui y ont le moins accès ; inversement, les multimilliardaires n’effectuent pas le moindre travail réel. Nous vivons dans une société qui non seulement ne condamne pas moralement cet état de fait, mais qui le glorifie comme une « réussite », et comme une chose bien « naturelle ». J’ai la faiblesse de penser qu’il est un avenir où les humains porteront rétrospectivement le même regard sur tout cela que celui que nous pouvons porter aujourd’hui sur l’esclavage, et sur sa justification par des penseurs tels qu’Aristote.
En espérant avoir répondu à votre question.






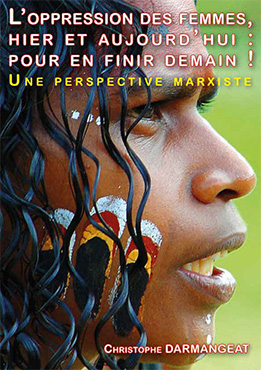

Merci ! Si j'ai bien compris: la difficulté venait de la différence taux de profit normal moyen (10%) qui dans l'exemple est une captation pure de la survaleur (grâce à la propriété des moyens de production) vs le taux de profit apparent où celui-ci - en plus de la captation de la survaleur (10%) - vient couvrir les aléas du risque (20%).
RépondreSupprimerEt bien sûr le risque ne crée pas "en soi" de la valeur (donc un possible profit), sinon, beaucoup joueraient à la roulette russe :)
Pour l'idéologie, autant la littérature est très complète sur la propriété des moyens de production comme "légitime" pour capter la survaleur, autant elle est peu disserte je trouve sur le mythe du risque, mais peut-être que je me trompe. Sur ce point, j'ai pris l'exemple du casino, car il me semble que beaucoup de petits actionnaires avancent l'idée du risque pris (et non le titre de propriété qu'est une action), comme au casino, comme légitime d'être rémunéré pour cela. Un peu comme une banque avec le taux d'intérêt sur un prêt, elle avance la notion de risque.
Merci
Se poser des questions de morale au sujet du capitalisme... ne croyez-vous pas que le propos est faussé d'avance? On peut bien sûr le faire et même avec un certain intérêt - car bien entendu la chose est pertinente -, mais il me semble que le faire dans ses termes à lui est un peu comme si on se posait des questions de morale devant une scène de la vie naturelle où une espèce en mangerait une autre... les termes semblent en peu déplacés, même si on peut les forcer pour lire ce qui y arrive. Car, vu que 'le capitalisme' se prétend une sphère autonome et indépendante de tout le reste, pour vraiment l'analyser il faudrait le faire d'un point de vue qui l'engloberait avec ce reste et non pas seulement dans ses termes à lui ou en plaquant sur lui les termes d'autres sphères de la vie sociale (comme l'esthétique, la religion, etc.). Cela m'a toujours semblé le point faible des analyses marxistes en anthropologie (par ex. lire les sociétés lignagères ou les relations des sexes en termes de 'classe' ou de 'production'), même si bien entendu ils peuvent être très utiles et stimulants pour la réflexion lorsqu'il sont bien faits. Cela dit, je connaissais pas ce livre et votre discussion est une motivation pour m'y renseigner.
RépondreSupprimerBonjour
RépondreSupprimerL'idéologie produit la morale d'une époque et pour paraphraser Marx, l'idéologie dominante d'une société est toujours l'idéologie de la classe dominante. Dans un mode de production capitaliste, les bourgeois dominent, donc c'est leur idéologie qui domine et comme il est important de masquer l'exploitation (consciemment ou non), l'idéologie actuelle la masque en justifiant leur domination grâce à leur mérite (la fameuse méritocratie) ou leur prise de risque
Pas mieux. Cela me rappelle le titre d'un petit livre : Leur morale et la nôtre. ;-)
SupprimerJe me suis demandé s'il n'y avait pas une erreur de calcul, histoire d'essayer de prendre notre CD en défaut. Si chaque bateau suppose un investissement de 100 et que j'en affrète 5, je dois récupérer 50 de profit. Si j'en perds un sur 5 et que je n'ai que le taux de profit moyen de 10 %, je n'aurais gagné que 40 (10 % de 4x100) en plus d'une perte de 100 (un des 5 bateaux). Je dois donc gagner les 50 de profit moyen sur les 5 bateaux affrétés, plus le remboursement de ma perte, soit 100. Total, je dois récupérer 100 + 50 = 150 sur les 500 investis au départ. Cela ferait 150 / 500 = 30 % ? pas exactement car seuls 4 bateaux rentreront au port... donc chaque bateau qui rentre doit me rapporter un quart de ces 150, soit 37,5 chacun. Par bateau cela fait un taux apparent de 37,5/100... et non 30 !
RépondreSupprimerC'est quand même plus simple avec des pirogues aborigènes dans un système sans monnaie où on se contente de quelques coups de massue ou de lance à l'arrière de la cuisse ! .
Alors, cher anonyme-mais-pas-tant-que-cela, figure-toi qu'en écrivant ce billet, j'ai entendu une petite sirène au fond de mon crâne qui me disait que le calcul n'était pas aussi simple que je l'affirmais. J'aurais dû l'écouter... Merci à toi en tout cas pour ta vigilance !
SupprimerBonjour,
RépondreSupprimerDans le monde diplo Verdun rend compte du livre l’énigme du profit :
Comment se fait il qu’après la vente et après avoir payé les salaires et le remboursement des coûts de production,il reste au capitaliste un supplément de valeur plutôt que rien?
Mais si on change de vocabulaire et au lieu de profit on écrit bénéfice ,alors on peut dire:
Prix de vente égale salaires plus matière première et usure machine auxquels on ajoute un bénéfice.
Il n’y a plus de mystère.
Reste évidement comment se calcule ce bénéfice avec la concurrence .
Mais j’ai un doute et je ne vois pas où se trouve le loup.
Merci de m’éclairer
Changer le terme de « profit » par celui de « bénéfice » ne modifie évidemment en rien les termes du problème, ni dans un sens ni dans l'autre. Toute la question est de savoir comment, étant donné la concurrence, « on ajoute un bénéfice ». Si c'est aussi simple, pourquoi ne pas quadrupler les prix ? Et si la concurrence intervient, pourquoi le prix de vente ne tend-il pas à rejoindre les coûts de production ? Voilà pourquoi cette question « sans mystère » occupe les économistes depuis quelques siècles...
SupprimerBonjour Christophe, et merci à touTEs pour ces remarques.
SupprimerIl me semble (je peux me tromper) que le prix de vente TEND à rejoindre les coûts de production. Mais il ne le rejoint jamais : sinon, le profit disparaîtrait et la production s'arrêterait. En situation de concurrence, si on vend un produit à 110, il y aura toujours un autre producteur pour se contenter de 109, un autre de 108, etc. Quand on commence à frôler les 100, alors la production cesse d'être rentable et il faut relancer la machine du profit : en diminuant les salaires, ou en extrayant de nouvelles matières premières moins chères, ou en robotisant la chaîne de production pour faire disparaître des postes, ou en torpillant des intermédiaires, ou en conquérant de nouveaux marchés, ou en produisant quelque chose de neuf (ou qui ait l'air nouveau et indispensable comme le dernier e-phone à la mode), etc. Les moyens ne manquent pas, mais ils sont tous brutaux, destructeurs ou polluants. Le système capitaliste contraint ses acteurs à cette fuite en avant : relever sans cesse le niveau des profits qui tend à baisser. C'est comme sur un vélo : si on arrête d'avancer, on tombe.
En disant que les capitalistes sont "contraints", je n'essaie pas de les plaindre ! Mais il me semble qu'ils n'ont pas le choix et que ce n'est pas une question de morale. Si on veut jouer un rôle d'entrepreneur ou d'investisseur dans ce système (on a toujours le choix individuel, bien sûr, de laisser tomber et de partir élever des chèvres) on est contraint de jouer ce jeu-là, d'exploiter sans scrupule, ou bien de disparaître.
Voilà. C'était ma traduction personnelle un peu simplette de "la baisse tendancielle du taux de profit". C'est simplet, parce que je ne tiens pas compte dans mon résumé de l'économie dite informelle, du travail domestique, de la financiarisation, des bulles d'investissement, etc. Mais est-ce que j'ai tort, globalement ?
Marc Guillaumie.
PS : La guerre, en régime capitaliste, réunit plusieurs de ces "avantages" : innovations techniques indispensables, conquête de nouveaux marchés, nécessité de reconstruire, etc. Ça relance bien la machine !
SupprimerM.G.
re-PS : Et surtout, par la militarisation de toute la société, la guerre permet de faire taire les critiques et de criminaliser le mouvement ouvrier, donc de baisser ou geler les salaires et de détruire les acquis sociaux qui coûtent "un pognon de dingue" à nos pauvres capitalistes.
SupprimerM.G.