Inégalités, hiérarchie, stratification : quelques réflexions

Ayant presque achevé mon livre sur les confrontations entre collectivités humaines – j’en suis à polir le texte final – je change de thème pour me plonger dans les questions qui vont m’occuper dans les années à venir : celles du développement des diverses inégalités au cours de l’évolution sociale pré-étatique.
Vaste sujet, évidemment, et la première difficulté sur laquelle on bute est celle des définitions. Je propose donc quelques réflexions préliminaires – et tout à fait insuffisantes – pour effectuer un premier débroussaillage du terrain.
Inégalités, hiérarchie, stratification... on retrouve partout ces termes dans la littérature. Toute la question, c’est de savoir ce qu’ils recouvrent, et s’il y a une chose claire, c’est que ce n’est pas clair ! D’où de longs dialogues de sourds, soit parce qu’avec les mêmes mots, les auteurs ne parlent pas de la même chose soit (et à mon avis c’est encore plus fréquent) parce qu’ils ne savent pas eux-mêmes de quoi ils parlent au juste, et que ce flou artistique permet de jeter un voile pudique de généralités sur tout ce qu’on ignore, et sur quoi il faudrait justement se questionner.
Commençons donc pas à pas.
Inégalités
Une inégalité est un rapport entre deux quantités (c’est ce qui sépare l’inégalité de la différence, qui elle, est qualitative). Tout ce qui est « plus grand que » ou « plus petit que » autre chose est une inégalité. Dans un ensemble d’élements tel qu’une société, une inégalité définit aussi ce que les mathématiciens appellent une relation d’ordre : si A est plus petit que B et B plus petit que C, alors on peut ranger A, B, et C dans une série où la quantité considérée sera continument croissante. Si l’on parle des humains, on trouve évidemment d’innombrables inégalités : des inégalités d’âge, de taille, de poids, de performance sur tel ou tel exercice… la grande question est évidemment de savoir quelles sont les inégalités qui font sens socialement (personne, je crois, n’a jamais prétendu expliquer les phénomènes sociaux par les inégalités de poids ou de taille). Avant de revenir plus loin sur ce point, deux premières conclusions :
- tout type d’inégalité définit une relation d’ordre (un rangement)
- « inégalités » en soi ne dit pas quelle est la variable (la quantité) utilisée pour établir cette relation – et rien ne dit évidemment que les différentes variables donneraient le même classement.
Hiérarchie
Une hiérarchie est nécessairement liée à une inégalité : toute hiérachie est une relation d’ordre (A est au-dessus de B, B est au-dessus de C, donc A est au-dessus de C). Il n’est pas vraiment facile d’identifier ce qui pourrait distinguer la hiérarchie de l’inégalité. Une possibilité serait de dire que l’idée de hiérarchie comporte le fait d’être efficiente : ce n’est pas une simple inégalité, c’est une inégalité qui produit le fait que ceux qui sont « les plus… » quelque chose sont aussi « au-dessus » des autres. Mais en réalité, on pourrait facilement trouver des exemples qui contredisent cette proposition. Dirait-on aussi que « hiérarchie » a quelque chose de plus politique, et se rapporte au pouvoir ? C’est vrai sur le plan étymologique, mais il y a longtemps que l’usage a débordé cette acception (le dictionnaire donne d’ailleurs du mot hiérarchie une double définition : celle d’un emboîtement de pouvoirs, et celle d’une simple relation d’ordre). On parle de la hiérarchie mondiale de tennismen par exemple, cela ne signifie absolument pas que le n°1 dispose d’un quelconque pourvoir sur le n°2 (ni sur les autres). Là encore, hiérarchie est une autre manière de dire « classement », et donc, relation d’ordre. Au bout du compte, hiérarchie est donc un synonyme à peu près parfait d’inégalités : le premier terme ne dit clairement rien de plus, ni rien de différent du second.
Stratification
Ajoutons un troisième mot celui de stratification. Si des individus (ou des groupes sociaux) sont « les uns au-dessus des autres », cela veut dire qu’il existe une axe (une variable, une quantité) qui permet de les classer et de déterminer que les uns correspondent, de ce point de vue, à une quantité plus élevée que les autres. Tout au plus peut-on dire que les strates renvoient davantage à l’idée de groupes : on ne parlerait pas de strates si la relation d’ordre concernait seulement des individus. La stratification, c’est donc une inégalité / hiérarchie plus des groupes (ou des classes). Cette nuance n’est pas inutile, mais elle reste tout à fait mineure lorsqu’on le rapporte à la question centrale, toujours la même : quelle est la variable retenue pour définir la relation d’ordre ?
Quelles sont les bonnes questions ?
Donc : inégalités, hiérarchies, stratification, c’est un peu du pareil au même – au mieux, il n’y a que les micro-nuances ou des implicites qui changent. Discuter pour savoir si tel phénomène est une inégalité, une hiérarchie ou une stratification n’a donc guère de sens. La seule question qui vaille est : dans les sociétés humaines (et vivantes en général), quelles sont les variables qui définissent des inégalités / hiérarchies / stratifications (appelons cela IHS pour évacuer la question terminologique) pertinentes ?
Il me semble qu’en première approche, on peut établir trois grandes catégories.
- Les IHS d’honneur (ou de prestige). Ce sont celles qui mettent en jeu des titres, des noms, des distinctions, plus ou moins formalisées, mais qui ne procurent rien d’autre que du respect et, au plus, une influence informelle sur les autres membres de la communauté. Ce sont par exemple les médailles, la légion d’honneur, etc.
- Les IHS économiques (ou de richesse). Ce sont celles qui mettent en jeu des droits de propriété sur des biens – ceux-ci confèrent aux riches des pouvoirs sur les autres, mais des pouvoirs indirects, des pouvoirs médiés par les choses. Problème tout de même : l’esclave, qui est en même temps un bien, et le sujet d’un pouvoir direct de commandement. Comment s’en dépêtre-t-on ?
- Les IHS politiques. Elles concernent les relations de commandement, comme celles qui caractérisent l’État : une chaîne fonctionnelle de droits d’ordonner et de punir.
Évidemment, ce ne sont là que de grandes catégories, au sein desquelles il faut opérer des distinctions plus fines. Mais à tout le moins, il s’agit de ne pas les confondre, même et surtout lorsque dans une société donnée plusieurs IHS se recouvrent plus ou moins – et c’est bien pour cette raison qu’on a du mal à y voir clair.
Pour finir par une proposition évolutionniste, j’ai l’impression que ces trois types d’IHS apparaissent de manière cumulative dans les sociétés humaines. Il semble bien que toutes les sociétés qui connaissent des IHS politiques ont aussi des IHS économiques et d’honneurs, et que toutes celles qui ont des IHS économiques ont aussi des IHS d’honneurs – l’inverse n’étant pas vrai. Cette proposition séduisant doit cependant être articulée à la présence d’IHS de genre dès les premiers stades du développement social. Donc soit ma proposition est fausse, soit il faut considérer que les IHS de genre ne sont pas « politiques » et forment une catégorie spécifique. Pourquoi pas ?






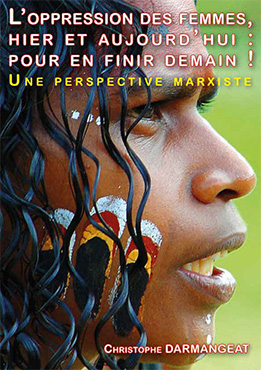

Ça renvoie à ce qu'a écrit B. Boulestin dans son article sur les chefs les princes et les rois.
RépondreSupprimerJe n'avais volontairement pas relu cet excellent texte avant d'écrire ces quelques lignes. Mais je ne doute pas qu'il y ait de fortes convergences - peut-être, aussi, certaines nuances ? À voir...
SupprimerJ'ai été relire hier : en effet, cela recoupe, à la virgule près ! J'ai donc rédigé un petit "Edit" en tête du billet !
Supprimer"La présence d'IHS"... Je constate avec soulagement que tu reconnais enfin la présence réelle du Christ dans le vin de messe : IHS (Iesus Hominorum Salvator) ! :)
RépondreSupprimerOups... Pardon !.. "Hominum". M.G.
SupprimerCe que je ne comprends pas, c'est que tu pointes qu'une inégalité est un rapport entre deux quantités (très bien), mais tu y amalgames ensuite à peu près tous les types de « stratification » et de « hiérarchie ». Or un rapport de domination politique ne concerne pas des quantités. De même, dans une société d'ordres ou de castes, le fait d'appartenir (de naissance, en général) à tel ou tel groupe prédéfini n'est pas une affaire de quantité (sauf à considérer comme une « quantité » l'indicateur d'appartenance, à savoir un booléen).
RépondreSupprimerTu as probablement raison sur le fait qu'une hiérarchie ne se ramène pas nécessairement à une inégalité quantitative. En revanche, c'est forcément une relation d'ordre, tout comme l'inégalité. Après, les « sociétés d'ordres », c'est encore autre chose : on peut admettre que les gens soient mis dans des cases (correspondant par exemple à une division du travail) sans que ces cases soient justement hiérarchisées. Mais ce type de remarque est exactement ce qui m'est utile, parce que cela souligne tous les pièges et tous les sous-entendus qu'il faut débusquer pour déminer le terrain et tenter d'avancer.
SupprimerPeut-être qu'on pourrait essayer d'établir une classification des origines d'inégalités, et appeler par exemple hiérarchie une relation d'ordre entre des statuts (eux-mêmes définis par un ensemble droits et de devoirs), en tant que cette relation engendre des inégalités : A a un statut supérieur à B, et c'est pour cela qu'il y a une inégalité entre A et B sur, par exemple, l'accès aux ressources alimentaires, ou aux honneurs, etc. Évidemment, on pourrait aussi se demander si ce n'est pas l'inverse : une égalité s'est établie de fait entre A et B, et la définition d'un statut est une stratégie de perpétuation de l'inégalité, en la légitimant (je pense ici à ce que Rousseau dit du droit du plus fort : d'abord je suis plus fort, et m'impose à toi ; mais, comme je ne le suis pas toujours, j'invoque un droit du plus fort pour me permettre de m'imposer à toi dans les cas où je manquerais de force pour y parvenir). On dirait alors que la hiérarchie est, non un type d'origine d'inégalité, mais une modalité perpétuation et de légitimation d'une inégalité. À voir...
RépondreSupprimerPas bien sûr de piger la différence que vous établissez entre hiérarchie et inégalités (et le fait que vous vous demandiez vous-mêmes si la causalité fonctionne dans un sens ou dans l'autre tend à me conforter dans l'idée que les deux termes sont à peu près interchangeables, et que « relation d'ordre » les regroupe de manière efficace).
SupprimerBonjour
RépondreSupprimerIl faut faire attention quand la réponse est dans la question de recherche : et si parfois il n'y avait pas d'inégalités (relation d'ordre partielle ou totale selon un certain critère qui peut être économique, symbolique, sexuel, racial, national, etc) ? mais seulement une relation d'équivalence (qui je le rappelle est réflexive, symétrique et transitive alors qu'une relation d'ordre est réflexive, antisymétrique et transitive). On peut grouper les individus par classes (pas au sens de "classes sociales" mais au sens mathématique) car ils ont certaines propriétés en commun.
Un exemple de dialogue de sourd entre Monsieur Darmangeat et Madame Goettner-Abendroth, l'un parle du matriarcat comme domination des hommes par les femmes et c'est vrai que cela n'a jamais existé, l'autre d'égalité dans la différence entre les hommes et les femmes. Par ce tour de passe passe sémantique, Monsieur Darmangeat démontre que le matriarcat n'a jamais existé alors qu'il ne se prononce pas sur l'existence de sociétés égalitaires entre les hommes et les femmes.
Pour approfondir la distinction entre inégalité (concept ordinal) et la différence (concept cardinal) qui est faite dans le texte, j'introduirai une distinction lexicale qui n'est pas faite dans les dictionnaires mêmes volumineux entre hiérarchique et hiériarchisation. On pourrait dire qu'une société est hiérarchisée si elle connaît une division sociale du travail, des spécialisations sans que nécessairement il y ait domination systématique d'une "classe" sur une autre. Et qu'elle est hiérarchique dans le cas contraire. Cela ouvre à la possibilité d'observer des sociétés égalitaires entre les hommes, entre les femmes et entre les hommes et les femmes.
On pourrait appeler ces sociétés communistes et non pas comme le fait Monsieur Darmangeat seulement les sociétés égalitaires entre les hommes qui peuvent être violemment patriarcales.
On pourrait appeler section les classes précédentes (sociales, sexuelles, raciales ou ethniques, nationalistes...) ce qui permettrait de récupérer les analyses connues sous le terme d'intersectionnalité. Voilà une question possible qui ne préjuge pas de la réponse :
Dans une ploutocratie patriarcale, une femme dominante, domine-t-elle les hommes dominés et c'est la domination sociale qui domine ou bien l'homme dominé domine-t-il la femme dominante et c'est la domination sexuelle (ou de genre) qui domine ?
En résumé, je critique dans ce court texte de ne pas laisser la place à l'existence de sociétés égalitaires dans le respect des différences
Cordialement
Thierry Bautier (thierrybautiervannes@gmail.com)
Je suis prêt à reprendre chacun des points avec vous :
RépondreSupprimer1 votre question de recherche est :le dvpt des inégalités au cours de l'évolution... je vous dis que vous supposez qu'il n'y a que des inégalités ce qui exclu des sociétés égalitaires
2 le dialogue de sourds sur le matriarcat est un fait. Vous n'utilisez ce terme que dans un sens extrême et pas dans le sens d'egalitaire entre les hommes et les femmes. Êtes vous d'accord ?
3 Dans votre livre " le communisme n'est plus ce qu'il etait" vous appelez communistes et égalitaires des sociétés égalitaires entre les hommes mais très violentes envers les femmes. Êtes vous d'accord ?Pour moi c'est grave car vous invisibilitez la vie de la moitié de cette humanité
4 mes propositions lexicales d'introduire une distinction entre hiérarchisée et hierarchique ainsi que d'appeler sections les groupes humains possédant certaines propriétés en commun, sans préjuger de l'existence d'une forme de domination ( c'est une relation asymétrique entre deux personnes) ne visent qu'à éclairer votre objet d'étude. Et surtout chercher honnêtement la vérité et non pas vous nuire en quelque façon.
A vous lire
Thierry BAUTIER
1. Si un article étudie la classification des vertébrés, il ne suppose pas qu'il n'existe que des vertébrés.
Supprimer2. J'utilise le terme dans le sens qui est le sien. Mais on peut changer le sens du terme, cela ne change absolument rien au raisonnement (cela le rend seulement plus confus) et au fait que Abendroth raconte des salades.
3. Si vous pensez que mon bouquin sur le communisme primitif invisibilise l'oppression des femmes dans les sociétés sans richesse, alors même qu'il est entièrement consacré à souligner son existence, vous avez, je le maintiens, un sérieux problème de lecture.
4. Je note vos propositions lexicales, mais elles ne me semblent pas pertinentes, pour une série de raisons qu'il serait bien long d'expliquer.
Je ne reprendrai que le point 3. C'est un fait. Vous appelez égalitaires puis communistes des sociétés patriarcales mais égalitaires entre les hommes ( les dominants pour l'inégalité de genre). Est-ce vrai ou faux ?
RépondreSupprimerJe ne reprendrais que le point 3. Page146 de votre ouvrage, vous qualifiez d'egalitaire sur le plan économique des sociétés violemment patriarcale et après vous les appelez communistes. Ce qui permet de justifier le titre. Mais une société communiste est égalitaire pour tout le monde et pas seulement une moitié de la société. C'est ce point lexical que je critique.
RépondreSupprimerJe précise à chaque fois qu'elles sont *économiquement* égalitaires, et que justement, sur le plan des rapports de genre, elles ne le sont souvent pas. Comment faut-il le dire ?
SupprimerJ'assimilerais les IHS de genre à des IHS d'honneur innées.
RépondreSupprimerIl me semble que les IHS de genre ne sont pas formalisées à l'origine (mais certains mythes qui légitiment la supériorité des hommes sur les femmes pourraient peut-être être assimilés à des formalisations ?), ce qui est un autre argument pour les exclure des IHS politiques.
Les IHS économiques sont liées au travail accumulé, hors les IHS de genre existent dans des sociétés ne connaissant pas le travail accumulé, elles doivent donc être indépendantes.
Je pense que les IHS d'honneur peuvent être acquises, ça me semble être le modèle du mérite, ou innées. Je pense dans ce dernier cas aux discriminations qui ne sont pas établies par des règles formelles mais plus ou moins reconnues par tous, appuyées par des représentations partagées (blagues, dictons, idées reçues). Dans ce cas elles sont reliées à une caractéristique de l'individu (particularité physique, appartenance tribale).
Les IHS de genre entreraient dans ce dernier cas.
L'Inuit à dreads
Ces sociétés ne peuvent être égalitaires sur le plan économique si cela ne concerne qu'une moitié de cette humanité. Et encore moins communistes. Ceux qui lisent votre livre devraient comprendre que des sociétés inégalitaires envers les femmes mais egalitaires entre les hommes sont inégalitaires envers les femmes !! Lapalissade. Mais ce n'est pas ce qu'ils comprennent le plus souvent car ils oublient le statut des femmes et falsifient les termes 'egalitaire' et 'communiste'. Est-ce plus clair ?
RépondreSupprimerLa seule chose claire, c'est que vous pensez que les autres ne savent pas mieux lire les livres que vous.
SupprimerSur le point 2. Je ne suis pas compétent pour juger le travail de Goetner-Abendroth mais je sais qu'elle a été virée de l'université en Allemagne pour avoir démontré que les philosophes jusqu'à De Beauvoir non compris, ne considèrent que le point de vue des hommes et hélas, elle avait raison.
RépondreSupprimerIndépendamment de la pertinence de 'Les sociétés matriarcales', elle propose une autre définition de matriarcat et vous n'avez jamais répondu je crois à la question de l'existence d'une société égalitaire entre les hommes et les femmes à l'intérieur de chaque division sociale du travail, sans non plus répondre à la question rigolote que je posais au début de nos échanges
Thierry BAUTIER
Et donc, vous n'êtes pas compétent, mais vous l'êtes quand même. C'est ça qui est formidable. Et sur ce, comme je ne m'appelle pas Brandolini et qu'à l'impossible nul n'est tenu, je vous souhaite une excellente soirée et vous propose que nous nous en tenions là (définitivement).
SupprimerJe ne suis pas compétent sur l'ethnologie mais uniquement sur le néolithique du grand ouest. Je continuerai à vous lire car vous êtes reconnu comme marxiste mais vous refutez les thèses du marxisme. Bizarre, bizarre...
RépondreSupprimerThierry BAUTIER
Et parmi les inégalités/hiérarchies faut il
RépondreSupprimerExclure par principes les inégalités physiques, biologiques ou d’intelligence?
Absolument pas. Ce sont aussi des inégalités / hiérarchies. En revanche, se pose la question de savoir comment elles se transcrivent en termes de rapports sociaux. Et c'est là qu'il faut faire très attention à ne pas assimiler sans ambages les unes aux autres.
SupprimerIntéressant. Soit que les sociétés parfaitement égalitaire eliminaient toutes différences, soit qu'elles mettaient en place une responsabilité, donc un ordre hiérarchique, donc une inégalité. Comment des sociétés égalitaires peuvent gérer des ''boulets à la survie'' ?
SupprimerHello
RépondreSupprimerLa différence que je ferais entre " inégalités" et "hiérarchie" est le niveau de neutralité du terme.
Inégale sous entend un point de référence qu'est "l'égalité". Hiérarchie ne sous entend pas ça .
Si je dis que la société médiévale est inégalitaire, j'ai déjà un pied dans la révolution. Si je dis qu'elle est hiérarchisée je suis moins dans le jugement de valeur, plus neutre.
En êtes-vous bien certain ? On a quand même le sentiment que l'égalité est tout autant le pendant de la hiérarchie que de l'inégalité - ne serait-ce que dans notre fameux « liberté, égalité, fraternité ».
Supprimer