« Classes sociales et communisme primitif », un entretien dans Cause commune
Je reproduis ici l'entretien que m'a accordé Hoël Le Moal pour la revue Cause Commune, et publié récemment sur son site web.

CC : L’idée de « communisme primitif » semble avoir exercé une grande fascination sur Marx et Engels. Cette hypothèse du « communisme primitif » recueille-t-elle aujourd’hui les suffrages des ethnologues ?
Je ne crois pas que Marx ait jamais parlé du « communisme primitif » dans un texte public. En tout cas, Engels, dans le livre qu’il a consacré au sujet après la mort de son ami, parle pour sa part de « l’économie communiste domestique ». Au-delà de ces détails terminologiques, la question est de savoir si, comme ces deux théoriciens avaient été amenés à le penser, les premières sociétés humaines ont effectivement été organisées d’une manière que l’on peut qualifier de « communiste ».
Évidemment, tout dépend de la définition que l’on donne à ce mot. Si on le comprend comme une collectivisation intégrale, où toute idée de propriété privée était absente, voire qui, dans les temps les plus anciens, s’étendait aux relations sexuelles, comme le défendait Lewis Morgan, alors il est clair que ce « communisme primitif » n’a jamais existé nulle part. Si, en revanche, on adopte une définition plus raisonnable (et plus utile), il en va tout autrement. Aucun anthropologue ne nierait que les sociétés de chasseurs-cueilleurs mobiles, si diverses soient-elles, sont toutes marquées par le libre accès de chaque individu à une portion du territoire et à ses ressources, par des mécanismes puissants de répartition des produits et par le fait que posséder des biens ne peut jamais y servir à nouer, ou à dénouer, des rapports sociaux. Comme le disait Alain Testart, ces sociétés ignorent la richesse – ce qui n’empêche nullement les besoins humains d’y être satisfaits ! Et des centaines d’observations ethnologiques attestent que, pour les individus qui y vivaient, accumuler des biens matériels, ou même s’efforcer de posséder davantage que leur voisin, semblait une idée totalement incongrue.
Ainsi, les inégalités socioéconomiques ne sont pas une donnée de la nature humaine, mais un produit (assez tardif) de l’évolution sociale.
CC : Est-il possible de retracer rapidement les diverses hypothèses quant à l’émergence de ces inégalités socioéconomiques antérieures à l’apparition des classes ?
Cette question de l’émergence est absolument passionnante, et plus on la creuse, plus on découvre à quel point elle est complexe.
Pour commencer, peut-être faut-il rappeler qu’il existe des inégalités qui ne sont pas d’ordre économique et qui, chronologiquement, ont précédé les différences de richesse. C’est en particulier le cas des inégalités de genre, dont tout laisse penser qu’elles étaient présentes dès le Paléolithique, c’est-à-dire l’époque de la chasse-cueillette. Contrairement à ce que Lewis Morgan puis Engels avaient pu croire sur la base de la documentation de leur temps, la domination masculine est manifestement un phénomène très ancien dans les sociétés humaines, et qui n’a donc pas émergé dans le sillage de la formation des classes sociales. Sans m’étendre sur ce point, je renvoie les lecteurs qui seraient intéressés pour en savoir plus à mon livre, Le communisme primitif n’est plus ce qu’il était (Smolny, 2022), qui s’efforce de mettre à jour les raisonnements marxistes sur cette question en fonction des connaissances actuelles.
En ce qui concerne les inégalités socioéconomiques, bien des questions se posent. Pour commencer, celle des raisons qui les ont fait naître. Si l’on est un tant soit peu matérialiste, on ne peut se satisfaire de réponses qui en situent la cause dans quelque changement des mentalités ou des croyances religieuses. Il est clair que les inégalités naissantes se sont accompagnées d’un bouleversement de la morale égalitariste qui prévalait jusqu’alors ; mais il ne faut pas confondre la cause et la conséquence ! Si l’on privilégie donc des facteurs matériels, indépendants de la volonté humaine, ceux-ci ont été traditionnellement situés dans le développement de l’agriculture et de l’élevage – ce qu’un archéologue marxiste du milieu du XXe siècle, Gordon Childe, a appelé la « révolution néolithique ». Cette idée procédait avant tout des observations ethnologiques : les chasseurs-cueilleurs sont égalitaires, alors que les cultivateurs ne le sont pas. Cette relation est globalement vraie, mais elle connaît tout de même de sérieuses exceptions dans les deux sens : il existe des chasseurs-cueilleurs nettement inégalitaires, et des cultivateurs égalitaires. C’est pourquoi, il y a quelques décennies, l’anthropologue Alain Testart a proposé de considérer que la variable-clé dans cette affaire n’était pas en soi l’agriculture, mais le stockage. Même s’il faut probablement affiner cette proposition, elle cadre en tout cas nettement mieux avec les faits observés.
Reste à savoir comment on explique le lien entre l’agriculture (ou le stockage) et le développement des inégalités. Classiquement, cette explication s’appuie sur la notion de surplus. En gros, l’agriculture a augmenté la productivité du travail ; c’est donc avec elle que, pour la première fois, les humains pouvaient produire davantage qu’ils ne consommaient pour survivre et, le cas échéant, être exploités. Cette idée (dont on trouve les traces, bien avant le courant marxiste, dans certains écrits du XVIIIe siècle) a le mérite d’être à la fois simple et séduisante ; pour autant, elle ne me convainc guère, pour toute une série de raisons. Sans les citer toutes, on peut au moins remarquer que cette explication est incomplète : en admettant même qu’elle soit juste, elle dit pourquoi il est devenu possible d’exploiter le travail humain, mais pas pourquoi cette possibilité s’est réalisée.
CC : On associe souvent la « classe » à une position au sein du processus de production. En gros, il y aurait dans une société donnée des individus productifs qui travailleraient au bénéfice d’un groupe improductif. Peut-on dater l’apparition d’une telle division sociale ?
On aimerait bien ! En réalité, c’est très difficile, pour deux raisons principales.
La première, c’est que le processus a évidemment été graduel : on n’est pas passé directement de sociétés où tout le monde accomplissait les tâches productives à une situation où une minorité était entretenue par les autres. Et l’ethnologie est pleine de ces situations intermédiaires, avec des personnages qui sont clairement mieux dotés que les autres, qui exploitent à un degré ou à un autre femmes, esclaves ou dépendants, mais qui ne sont pas pour autant de purs possédants, et qui continuent de chasser, de travailler la terre ou de s’occuper des animaux – tout en étant éventuellement déchargés de certaines tâches considérées comme indignes d’eux. Le second problème, c’est que tout cela ne laisse guère de traces archéologiques.
Ce que l’on peut dire, de manière très générale, c’est que pendant des dizaines (sinon des centaines) de milliers d’années, au Paléolithique, les sociétés humaines ignoraient la richesse et les inégalités socioéconomiques ; que la division du travail se limitait au sexe et à l’âge, et que l’exploitation y était virtuellement absente. Puis tout cela a commencé à changer dans des communautés moins mobiles, où la production matérielle était plus importante, et donnant lieu en particulier à un stockage alimentaire. Un lent mouvement s’est alors enclenché, qui a peu à peu mené à la formation d’authentiques classes. Tous ces moments sont très compliqués à dater, d’une part parce qu’il s’agit de processus graduels, d’autre part parce que les indices archéologiques sont ambigus. Ainsi, on date généralement les premières communautés sédentaires d’environ –10 000, au Proche-Orient. Mais ces communautés étaient-elles déjà marquées par des inégalités de richesse, et à quel degré ? Et de telles inégalités n’étaient-elles pas déjà apparues bien avant, par exemple dans les plaines russes autour de –30 000, avec le site un peu énigmatique de Sungir ? Les préhistoriens ne peuvent que faire des hypothèses, en essayant de soupeser leur vraisemblance.
CC : L’émergence de la classe semble liée à la confiscation de la terre. Quand s’est-elle produite ? Dans quelle région du monde d’abord ? Sait-on pour quelles raisons ?
En bien des endroits, l’appropriation de la terre a effectivement constitué un levier décisif pour la formation des classes. Il faut rappeler que dans les premières sociétés de cultivateurs, où l’on pratique l’abattis-brûlis et où il n’y a pas de champs permanents, la règle quasi universelle veut que la terre soit détenue collectivement et appropriée par celui qui la défriche, aussi longtemps qu’il la travaille. Après quoi, elle retourne au pot commun. La propriété moderne de la terre constitue une rupture majeure, dans la mesure où elle permet à un individu de posséder une terre même si elle n’est plus travaillée… et donc d’exiger que celui qui veut l’utiliser lui verse une rente. Le propriétaire foncier vivant de ses rentes et le paysan sans terre sont donc les deux faces de la même pièce, inconnue dans l’ancien type de propriété. Il n’est pas très difficile d’imaginer que le passage d’un système à l’autre se fait lorsqu’en raison de la croissance démographique, les terres libres viennent à manquer. Elles peuvent alors être monopolisées par une minorité, qui exploitera les cultivateurs dépourvus de terres.
Cependant, il faut se méfier d’y voir la voie universelle de la formation des classes. En Afrique subsaharienne, par exemple, le basculement entre les deux systèmes de propriété n’avait pas eu lieu avant la conquête coloniale. Cela n’empêchait nullement de nombreux et puissants États d’y avoir existé depuis des siècles, dont la couche dirigeante tirait ses revenus de l’esclavage. En quelque sorte, on peut exploiter les travailleurs par un moyen indirect, en possédant les moyens de production. Mais il est également possible de les exploiter en possédant des droits directs sur leur personne, qu’il s’agisse d’esclaves ou de tout autre forme de dépendants. Tout cela dessine de multiples voies vers la formation (et même la définition) des classes.
CC : Doit-on distinguer l’apparition des « classes » et celle des « sociétés de classes » ?
C’est une excellente question, à laquelle je n’ai pour le moment pas de réponse qui me satisfasse. L’idée n’est pas absurde : certains auteurs ont par exemple proposé de distinguer les sociétés « à esclaves » des sociétés « esclavagistes », l’idée étant que le phénomène de l’esclavage peut exister sans pour autant structurer la société et y jouer un rôle central. Dans cette idée, on pourrait donc envisager que certaines sociétés aient connu des classes (ou des embryons de classes) sans être pour autant structurées autour de l’appropriation du travail humain. Par ailleurs, la notion de « classe » est employée dans des sens très divers, et évidemment, selon la définition qu’on utilise, on peut en trouver presque partout, ou presque nulle part !
Quoi qu’il en soit, les classes n’étant pas apparues spontanément, il faut bien trouver des mots et des catégories pour qualifier les différents stades de leur développement, depuis les premiers exploiteurs occasionnels et, si j’ose dire, au petit pied, jusqu’aux puissants vivant dans le luxe et sans accomplir le moindre travail de production. La difficulté supplémentaire est que si les sociétés ont suivi une même grande direction générale, elles ont emprunté des chemins particuliers, et parfois très différents. Le statut des exploités et le ressort de leur exploitation ont considérablement varié d’un endroit à l’autre du globe – et tout cela est extrêmement difficile à appréhender via l’archéologie, qui ne dispose, au mieux, que de traces matérielles.
Quel était au juste le statut social de l’individu inhumé avec des richesses considérables sous le tumulus Saint-Michel à Carnac ? Quel rapport entretenait-il avec tous ceux qui ont contribué à construire sa tombe monumentale ? Plus près de nous, à l’âge du fer, qui était au juste la « Dame de Vix » et comment avait-elle accumulé les incroyables richesses qui furent enterrées avec elle ? Nous ne pouvons avancer que des hypothèses très fragiles, et nous cachons souvent notre ignorance sous des mots fourre-tout tels que « chefs » ou « princes ».
Mon avis est que, sur tout cela, nous n’en sommes en réalité qu’aux balbutiements de la recherche. Nous manquons cruellement de catégories solides, fondées sur une analyse méthodique des données ethnographiques, qui puisse nous fournir des repères fiables sur les différentes voies par lesquelles les sociétés ont évolué jusqu’aux classes et à l’État.






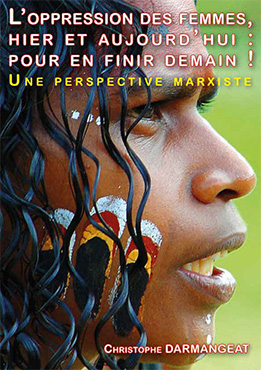

rassurez-moi, quand l'intervieweur dit : "En gros, il y aurait dans une société donnée des individus productifs qui travailleraient au bénéfice d’un groupe improductif", il veut bien parler des RSAstes dont le PCF en la personne de son (médiocre) timonier FR s'est dernièrement décidé à chasser ? Logique, après la mise sur pied d'une fédération PCF de la chasse après tout...
RépondreSupprimerAh bénis soient les temps paléolithiques où ils trimaient tous et toutes -enfin, 4 heures par jour si on se souvient de de Shalins :)
Je ne suis pas bien certain de comprendre le sens de votre premier paragraphe. Pour ce qui est du second, méfiez-vous des chiffres de Sahlins, ils sont tout de même largement sous-estimés (les rares données disponibles donnent plutôt un travail hebdomadaire d'environ 40h).
Supprimerle premier paragraphe était évidemment sarcastique. Je n'ai, à la différence du "camarade" Fabien Roussel, rien contre les RSAstes. Merci pour la précision. On est tout de même sur une hypothèse bien inférieure au travail actuel, tout type d'activité confondue avec un peu plus de 5 heures quotidiennes...
RépondreSupprimerEn fait, les rares chiffres disponibles sur les chasseurs-cueilleurs tournent plutôt autour de 40 h par semaine. Certes, ce n'est pas l'usine, mais ce n'est pas non plus le Club Med (d'autant que les conditions de travail sont loin d'être toujours plaisantes).
SupprimerBonjour ! J'ai une question qui concerne l'activité économique des chasseurs-cueilleurs australiens (je suis aussi preneur d'informations sur les autres chasseurs cueilleurs non stockeurs et sans biens W). J'ai lu plusieurs fois qu'ils échangeaient des objets entre groupes, mais je n'ai pas compris à quelle échelle. Est-ce qu'un membre d'un clan intéressé par un objet fabriqué par quelqu'un du même clan devait nécessairement l'échanger contre un autre pour l'obtenir ? Jusqu'où s'étend la propriété privée des objets de la vie courante (hors nourriture) pour les chasseurs cueilleurs non stockeurs ? En somme, quels sont les objets concernés par ces échanges, devaient ils être nécessairement immédiatement réciproques (un objet contre un autre ou bien des cadeaux espacés dans le temps par exemple) et surtout entre individus de quels groupes ? (les familles, les clans, les nations ou même au-delà ?)
RépondreSupprimerEn espérant que ma question est suffisamment claire :-)
Il y a une chose parfaitement claire, c'est que vous dites que vous avez une question, mais en fait il y en a au moins trois ou quatre différentes. ;-)
SupprimerChacune mériterait un assez long développement (et qui plus est, sur des dimensions sur lesquelles les données sont très lacunaires). Je ne vois pas comment vous répondre en quelques lignes ; je note le thème pour un billet... un de ces jours !
J'ai triché sur le nombre de questions pour la bonne cause ! Je n'avais pas envie de vous harceler avec 4 commentaires différents 😅
SupprimerEn tout cas, merci beaucoup de prendre le temps de faire un billet sur ce sujet.